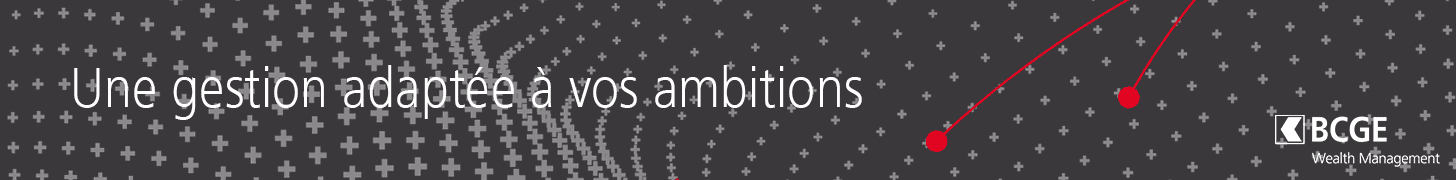Bien avant que l’intelligence artificielle (IA) ne s’invite dans nos vies, deux écrivains avaient déjà entrevu le piège qui se referme aujourd’hui. Et si l’IA, en produisant toujours des réponses “moyennes” – des formulations construites à partir de la masse des savoirs existants, qui condensent ce qui a déjà été dit en lissant les écarts, en simplifiant les nuances et en ramenant l’originalité à un consensus statistique – nous enfermait dans un monde où le possible se réduirait peu à peu ?
Le romancier autrichien Robert Musil l’avait pressenti il y a près d’un siècle, tout comme Jean Baudrillard – qui a inspiré le film Matrix – disparu en 2007 : toute nouveauté finit par être digérée, toute critique absorbée… Car ce système de la moyenne possède un pouvoir redoutable: il intègre sa propre critique pour se renforcer, transforme l’objection en signal, la contestation en contenu exploitable. Aujourd’hui, ChatGPT incarne cette mécanique — fascinante, mais entropique. Comment ces deux penseurs, qui n’ont jamais connu l’IA, ont-ils pu avant l’heure comprendre e piège : celui d’un savoir qui s’auto-résume… et s’auto-annule ?
Robert Musil (1880-1942), romancier et essayiste autrichien, formé aux sciences exactes et à la philosophie, est l’auteur de l’immense fresque inachevée L’Homme sans qualités (1930-1942), méditation sur la crise des valeurs et la dérive d’une société obsédée par a technique. Ses Essais et son Journal prolongent cette réflexion, disséquant la fragilité de l’individu face aux forces occultes et aux grandes révolutions scientifiques de l’époque.
Jean Baudrillard (1929-2007), sociologue, philosophe et essayiste français, a marqué la pensée contemporaine avec La Société de consommation (1970), Simulacres et simulation (1981) ou encore La Transparence du mal (1990). Il y développe une intuition vertigineuse : les signes et les modèles finissent par remplacer le réel, et tout système tend à intégrer sa propre critique, neutralisant la subversion en la transformant en marchandise ou en spectacle. Sa pensée a fortement influencé la culture contemporaine : Dans le tout début du film Matrix (1999), Thomas Anderson, alias Neo, se terre dans son appartement pour y cacher des disquettes. Il ouvre un livre qu’il dissimule dans sa bibliothèque, à l’intérieur duquel il cache ses supports informatiques. Ce livre, c’est Simulacres et simulation, l’opus magnum de Baudrillard : Neo n’ouvre pas simplement un livre, il découvre un passage interne, un contenant fictif, comme pour suggérer que le savoir critique est lui-même déjà “encavé” afin de cacher d’autres vérités.
La moyenne n’est pas une simple addition : c’est une force d’absorption
Ni l’un ni l’autre n’ont connu les algorithmes, mais leurs diagnostics résonnent avec une acuité troublante à l’heure des IA génératives. Après tout, qu’est-ce que ChatGPT, sinon la matérialisation de ces deux intuitions : une machine qui calcule la moyenne du déjà-dit et qui, à chaque nouveauté produite par l’humain, s’empresse de l’absorber, de la digérer, de la rendre disponible?
Lire Musil et Baudrillard aujourd’hui, c’est remonter à la source d’une critique qui n’avait pas encore de nom mais déjà une lucidité : celle d’un monde où la pensée se dilue dans l’agrégation et où la rébellion elle-même devient un produit du système qu’elle voulait ébranler.
On croit toujours que l’originalité échappera à la moyenne. On se rassure en se disant qu’il restera toujours une invention, une œuvre, une pensée capables de briser la loi des grands nombres. Mais la moyenne n’est pas une simple addition : c’est une force d’absorption. Elle finit toujours par rattraper ce qui la conteste. L’originalité n’échappe pas à son destin : tôt ou tard, elle est intégrée, cataloguée, citée, enseignée. Elle devient un point de référence, puis une banalité.
« L’homme moyen est une fiction, mais c’est une fiction qui gouverne désormais la vie réelle. »
Robert Musil
C’est là que Musil et Baudrillard se rejoignent et font figure de précurseurs en matières de réflexion sur l’IA. Musil nous a montré la tentation de la moyenne, ce nivellement progressif où toute singularité se dissout dans la statistique, où la précision se perd dans la généralité. Ainsi selon lui « les statistiques remplacent l’expérience personnelle ; elles sont devenues la base de la réalité moderne. » Baudrillard, lui, a poussé le constat plus loin : le système n’a pas besoin de censurer sa critique. Il l’intègre, il la recycle, il en fait un signe de sa vitalité. La subversion devient marchandise, la révolte devient tendance, et l’anti-système devient l’un des plus sûrs piliers du système.
Avec l’intelligence artificielle, ce double mouvement se cristallise : la machine produit en permanence la moyenne des discours déjà existants, mais elle incorpore aussi, au fil de ses mises à jour, les écarts, les inventions, les critiques qui tentaient de la dépasser. Ainsi «tout ce qui s’oppose au système lui sert encore » : même la nouveauté la plus radicale est condamnée à être réintégrée dans le flux, sous forme de donnée supplémentaire, de variation statistique. La critique se retrouve absorbée par ce qu’elle visait à détruire. Il en résulte une étrange entropie : plus on produit de différences, plus on renforce la moyenne. Plus on invente des critiques, plus le système s’enrichit de leurs signes. Tout devient information, et l’information devient indifférenciée.
« Le système absorbe tout ce qui lui est extérieur, y compris sa propre critique. »
Jean Baudrillard
Alors, la question qui demeure est vertigineuse : comment exister en dehors de la moyenne ? Faut-il inventer un silence, une opacité, une forme d’irréductible qui échappe à la capture statistique ? Ou faut-il accepter que la pensée contemporaine ne se déploie plus dans la résistance mais dans la vitesse de sa propre récupération ? Peut-être que la véritable singularité aujourd’hui n’est plus dans la production d’idées nouvelles, mais dans la capacité à leur offrir un espace où elles ne soient pas immédiatement absorbées.