Une apparente contradiction
Le concept de luxe plonge ses vraies racines sémantiques dans la brillance (grec leukos), la luisance (latin luceo) et bien sûr la lumière (latin lux). La racine indo-européenne *leuk porte également le sens de ce qui est sous la lumière, c’est-à-dire ce qui est visible parce qu’éclairé. C’est de là qu’il évoluera d’ailleurs jusqu’à ce qui permet de voir : la vue (l’une des connotations de lux en latin). Alors parler de luxe invisible est bien une contradiction dans les termes : en effet, l’autre sens, péjoratif, qui existe dans luxure par exemple, provient quant à lui d’une autre racine *leug signifiant funeste, brisure, que l’on retrouve dans lugubre, luxation (déboîtement) ou encore luxuriance (désordre). Peu d’observateurs ont relevé cette hybridation sémantique donnant à un même vocable luxe, deux sens aussi contradictoires, causant d’interminables débats quant au vrai sens du luxe. D’ailleurs, si l’allégresse promise par le luxe anime tous les sens, c’est à la vue qu’il s’adresse dans tous les cas.

En fait, il ne saurait exister de luxe sans un œil attentif. La robe d’un très grand vin doit être vue avant qu’il soit bu, idem pour une soie ou une dentelle portée autant sur la peau qu’au regard, un cuir lisse et brillant, un bijou dans son écrin. Une grande musique n’est-elle pas mise en scène qu’en habit d’apparat ? Ses instruments ne sont-ils pas des objets d’art ? Quant aux grands parfums, que seraient-ils sans leurs sublimes flaconnages issus de la Vallée de la Bresle, cette région de Normandie, surnommée la Glass valley, qui totalise plus de 70 % de la production mondiale de flacons de luxe pour la parfumerie et les spiritueux ?

La discrète séparation du luxe
Et pourtant, pour se distinguer réellement, le luxe doit conserver du secret, protéger son aire de discrétion (séparation). Car le luxe, assurément, ségrègue. Il offre de signifier sa différence par la distance qu’il impose à son accès, quasi-irrattrapable pour le commun des mortels. Seul un petit nombre est sensé pouvoir pénétrer ses univers, et en outre progressivement : par paliers. Mais cela n’a rien d’une simple formalité, pas plus que d’un privilège.
si l’allégresse promise par le luxe anime tous les sens, c’est à la vue qu’il s’adresse dans tous les cas.
Accéder au luxe est indissociable du choix de l’action et des efforts nécessaires (notamment pécuniaires et culturels) pour y parvenir, en fonction de l’altitude des strates convoitées. Y faire sa place impose même parfois que l’on soit agréé, que le candidat aux cercles fermés des élus du luxe (les élites) endure qu’on veuille bien accéder à ses demandes. Avec un peu de répondant, on intercèdera pour lui. Le luxe est aussi une affaire de groupes et de codes sociaux, de confiance et de ressemblance : il faut y être bien vu. Quoi qu’il en soit, le luxe n’est donc pas seulement lumière ou luisance mais également topos, en tant que champ d’expériences sublimantes. La réalité du vrai luxe, c’est qu’il n’est jamais utopique.
L’aristocratie du luxe
Il fut de tout temps réservé aux familles bien nées, provenant si possible d’une alliance immémoriale aux dieux ou quelque force céleste qui eussent en commun d’appartenir aux dimensions invisibles. L’actuel empereur du Japon ne descend-il pas en droite ligne de Jinmu (660 av. J.-C.), lui-même en filiation directe de la déesse japonaise du soleil Amaterasu ? Il y a certainement dans l’acquisition du luxe comme une rétroaction sur ses origines, une tentation de refonte native de son identité par l’accès à un principe primordial incorruptible : l’âge d’or. C’est en tout cas in illo tempore, en ces temps-là, que les dieux et les hommes méritants, redevenus héros immortels, cohabitaient. Tous les besoins y étaient satisfaits dans l’instant intemporel et dans l’abondance incommensurable, non comme une récompense mais comme un mode d’être. Fondamentalement, c’est à ce mythe invisible que le vrai luxe se réfère. Est-il illusoire pour autant ? Le mythe se jouerait-il de nous ?

La réponse est non. Non seulement parce que l’excellence requise dans la qualité du luxe lui est nécessaire pour manifester le mythe, le rendre visible, mais plus encore parce que ces domaines des dieux qui se matérialisent en strates, procèdent en fait d’une transformation de soi. Ce n’est pas par hasard que la métaphore alchimique soit omniprésente dans le luxe : on devient quelqu’un d’autre à son contact. Il y a dès lors quelque chose de philosophal dans la matrice du luxe. N’est-ce pas en effet par son œuvre que le diamant se départit de sa gangue chtonienne et redevient lumineux et céleste ? Que le minerai aurifère restitue l’or solaire ? Que l’écume de mer se transmute en perle ? Rien d’étonnant non plus que perdure de nos jours le souvenir des propriétés magiques ou médicinales de ces matériaux rares, consacrant le possesseur du luxe en oracle (il sait ce qu’il porte, il recommande) ou thaumaturge (il a l’autorité philanthropique pour prendre soin, pour s’occuper de « Causes »). Par nature, l’effet principal du luxe sera toujours de faire vivre un invisible réenchanteur. La seule condition requise est que la matérialité du luxe puisse coïncider avec une élévation de soi que seule l’éducation (ex-ducere, conduire, tirer hors de) permet. Sentir n’est pas sentir. Sentir c’est savoir qu’on sent et savoir qu’on sent c’est percevoir expliquait Maurice Merleau-Ponty dans La phénoménologie de la perception. S’il ne pourrait, à l’évidence, exister de luxe sans savoir, on peut se demander à quand l’annonce d’une alliance plus précise entre luxe et sagesse ?

Doit-on rappeler qu’à sa racine (*weid) le mot voir signifie justement connaissance et sagesse ? Un sens qui émerge de l’anglais wise (sage), non loin de l’allemand wissen (savoir) et du sanskrit veda (connaissance). Déjà philosophal, il n’y aurait rien d’anormal à ce que le luxe s’adresse davantage à la nature métaphysique de l’homme et de la femme, qu’à leur avidité consumériste, leurs manies exubérantes ou leurs désirs transgressifs. L’artisan du luxe, toujours un initié, porte à cet égard une immense responsabilité. Dire de son œuvre qu’elle s’entend nécessairement d’une réalisation parfaite, c’est la promettre à des perceptions si fines qu’elles transcendent le rapport simplement organique au luxe. C’est ainsi qu’elles échappent à la caducité et que l’essence du luxe, le sublime, ne se périme point. Seul le frivole pâtit du temps.
ce n’est pas par hasard que la métaphore alchimique soit omniprésente dans le luxe : on devient quelqu’un d’autre à son contact.
Pour exprimer ce sublime, le luxe s’est certes rendu maître dans l’art de conjuguer ses attributs matériels et cognitifs mais cela n’aurait pas suffi s’il n’avait pas, aussi, selon le néologisme formé par le théologien Rudolf Otto, maintenu sa fonction numineuse c’est-à-dire l’offre d’une expérience, au moins affective, du sacré. Le numineux, dérivé du latin numen, c’est la puissance agissante de la divinité, un sentiment de présence absolue, une présence divine. C’est proprement cette hiérophanie – du grec ancien hiéros, sacré, saint et phainein, rendre visible, faire connaître – est une manifestation du sacré, révélation d’une modalité du sacré, exaltée d’ailleurs sans complexe dans la modernité, qui signe, à notre avis, la profondeur invisible du rapport au luxe, tant dans ses dimensions symboliques qu’introspectives.

Le symbolique et le sacré
Comme on le sait le symbole est le signe bien visible d’un réel invisible. Or, tous les domaines du luxe regorgent de symboles, ne sont que symboles. Pour quel motif en user et abuser, si ce n’est pour manifester l’appartenance des marques à cette part d’invisible qui seule les sacralise, elles et leurs clients ? Ce qui fait la puissance du luxe, c’est en effet la vertu des pouvoirs qu’il confère sur son contingent d’invisible. On y recueille une titulature sur l’univers du luxe choisi, jalonnée de ses signes et rites et symbolisée par ses attributs mythiques savamment dosés de ce que Rudolf Otto désignait comme le mysterium tremendum et fascinans (le mystère qui impressionne et fascine).
tous les domaines du luxe regorgent de symboles, ne sont que symboles.
On y occupe aussi l’espace qui émerge de ses légendes, jusqu’à espérer conquérir cette sécurité intérieure inhérente aux mondes divins, immortels, stables, sans défaut. C’est pourquoi le seul travail bien fait ne suffit évidemment pas à faire du luxe, pas plus que la seule mise en scène des rêves, même les plus somptueux. Un usinage de pièces industrielles est aussi précis qu’une couture Hermès, une page des Scènes de la vie privée de Balzac est au moins aussi évocatrice qu’un storytelling de Christian Dior.
le luxe comble les mythes oubliés, les symboles déchus, les hiérophanies abdiquées. il resacralise.
Mais pour produire du luxe, encore faut-il garantir d’entrer en possession du sacré. Jean-Paul Sartre, qu’on n’attendait pas sur ce terrain, en eut l’intuition lorsqu’il nota dans L’Être et le néant que : le luxe ne désigne pas une qualité de l’objet possédé, mais une qualité de la possession.
Dimension introspective du choix
La dimension introspective du luxe appartient quant à elle pleinement au sujet, à celui qui acquiert des biens de luxe et use de ses services. Ce sont les intimes raisons du choix de s’allouer sa part de luxe qui meublent ici son invisible inconscient.

Qu’un conducteur placide subisse, dans sa Ferrari grise, les affres des embouteillages citadins, les uns y verront de la frime, les autres une malchance, les troisièmes la simple expression d’un goût personnel irrépressible pour les belles italiennes. Mais personne ne saura vraiment, au fond, pourquoi ce conducteur la détient, cette Ferrari grise. Le sait-il d’ailleurs vraiment lui-même ?
rien n’est moins superflu pour l’homme que de se libérer de la nécessité.
Peut-être s’agit-il d’un objet fétiche rêvé depuis l’enfance, qui exorcise son possesseur de tout vieillissement ? Peut-être que conduire cette voiture au grand jour vaut témoignage de fidélité œdipienne à sa marque-mère ? A moins qu’il ne préfère la conserver en sécurité dans un écrin amniotique et ne la sorte qu’en de rares occasions de fierté parturiente ? C’est cette relation intrinsèque sujet-objet de luxe qui est donc proprement invisible, alors que seuls l’utile et le nécessaire sont visibles en pratique. Or, le luxe existe justement pour s’en affranchir, car rien n’est moins superflu pour l’homme que de se libérer de la nécessité. C’est donc l’un des paradoxes du luxe que de permettre l’ostentation raffinée à d’éminentes fantaisies intérieures mais qui resteront, comme telles, invisibles.
Ostentation vitale
Si ce n’est pas l’ostentation en soi qui contredit le luxe, alors c’est du côté de l’austérité qu’il faut chercher le plus grand risque de disparition du luxe et des baisses de chiffre d’affaires. Il ne s’agit pas d’un truisme. Si l’austérité attaque le luxe, ce n’est pas tant comme obturateur de sa partie visible mais comme astringent mortel de son fond invisible, car en voilant le luxe, comme on voile un film argentique, on en détruit l’émulsion foncière : la créativité. Un survol de la relation des religions à l’ostentation du luxe nous le confirme. La civilisation indienne s’est toujours accommodée du faste, sacralisant ouvertement la sensualité (kama) autant que la richesse et le pouvoir (artha). Elle a toujours préféré le principe de libération et du devoir de caste à celui d’égalité. Et si le renoncement est extrêmement valorisé dans la culture indienne, il ne s’impose vraiment qu’en fin de vie.
les Japonais sont les champions du luxe invisible.
La dépossession et l’ascétisme sont alors perçus comme des caractéristiques de virtuosité spirituelle. En toute hypothèse, l’ostentation du luxe n’y est pas une faute. Le bouddhisme tolère quant à lui très bien les raffinements de la volupté et de la sensualité mais à la condition qu’ils ne nuisent pas à la conscience de leur vraie nature illusoire. La Chine confucéenne admet aussi le luxe visible, pour autant qu’il se conforme au rite (li) et au principe de face (mianzi). Il est conçu comme une obligation sociale correspondant à l’intensité de face qu’il convient de donner à chacun des membres de son cercle relationnel (guanxi). Cela peut se traduire par des cadeaux excessivement somptuaires car ce n’est pas le cadeau qui est donné en tant que tel, mais la quotité – invisible autrement – de face qu’il symbolise. Le taoïsme est quant à lui plus réservé, ce qui n’empêche pas son art de produire des œuvres de grande richesse, dès lors qu’elles ont, là encore, pour fonction d’exprimer ses symboles. Au Japon, les influences shinto et zen ont imposé leurs codes minimalistes et épurés mais en contrepartie d’un raffinement inouï dans la précision des détails, miniaturisés à l’extrême. Les Japonais sont, de ce point de vue, très certainement les champions du luxe invisible (à l’œil nu).
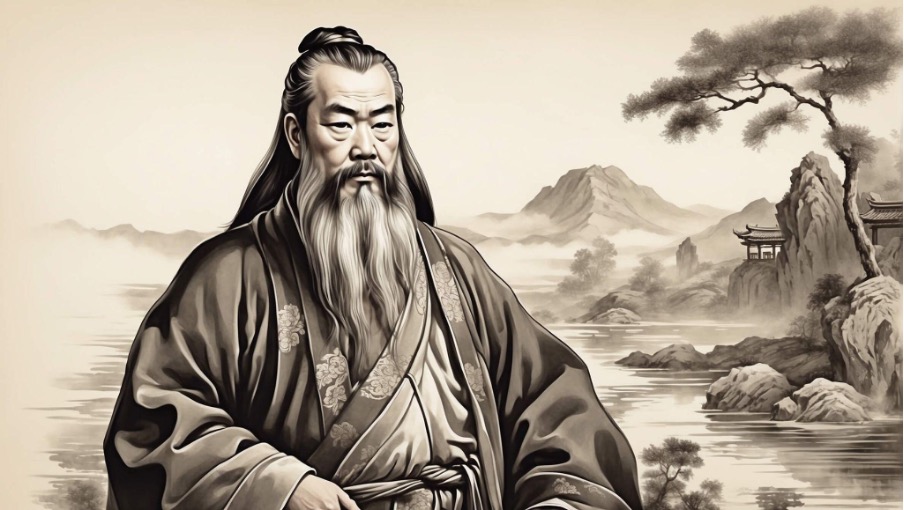
trouve ses racines dans les enseignements confucéens.
Les cultures islamiques sont quant à elles partagées selon les exemples qu’elles retiennent dans la conduite de Mahomet. Si les parfums et la gastronomie sont permis, la soie est interdite aux hommes. Il est en outre détestable de ressembler aux impies. Quant aux palais, on n’a pas de mal à comprendre qu’ils sont licites. En revanche, quel que soit le rang du musulman, aucune pompe n’est permise pour son enterrement. Dans le judaïsme, la pauvreté n’est jamais érigée en vertu car elle barre la route à l’étude. Et si la richesse est belle pour le vertueux, comme le rappellent les Maximes des Pères (Pirkei Avot), le luxe ne doit pas s’étaler, afin de ne pas stimuler la convoitise. En revanche, il n’est pas limité à l’intérieur de l’enceinte privée. Quant au christianisme, il professe que le luxe ostentatoire est mauvais car injuste, dans la mesure où la dépense qu’il représente pourrait mieux profiter aux plus démunis. Pourquoi cette extravagance ? Ceci aurait pu être vendu à bon prix et l’argent donné aux pauvres, tance l’Évangile (Mt 26 : 8-9).
la culpabilisation relative à l’ostentation naît donc principalement dans l’Europe catholique, mais s’accomplit drastiquement dans la Réforme, qui bannit notamment les icônes.
L’habitude du luxe étouffe la charité et rend les riches impitoyables, ajoutait l’abbé Nicolas-Sylvestre Bergier en 1788. Cela étant, l’Église s’est accordée le luxe pour Dieu. Suger de Saint-Denis (1080-1151), fondateur de la basilique royale éponyme, en fut le défenseur le plus vif, inventant les croisées d’ogive et le gothique flamboyant, assorti d’images, couleurs et vitraux. Le luxe ecclésial ne cessa pas et s’enrichit encore à la Renaissance, jusqu’aux célèbres excès du pape Jules II, surnommé Jules César II. On sait que la Réforme, en particulier luthérienne, naquit en réaction à ces abus d’opulence de la papauté. Volupté et jouissance s’en trouveront bannis des bonnes mœurs protestantes, mais pas pour autant les richesses, car les richesses, de qui procèdent-elles sinon de Dieu ? Mettait en garde Calvin, qui lui-même recevait un coquet salaire. La culpabilisation relative à l’ostentation naît donc principalement dans l’Europe catholique, mais s’accomplit drastiquement dans la Réforme, qui bannit notamment les icônes.
Privé de symbolique, le luxe n’a dès lors plus lieu d’être : plus de topos. Mais s’il disparaît du visible, ce n’est pas simplement par censure, par effacement, c’est aussi faute d’invisible à sustenter. Comme on l’a dit, la grande victime de cette indigence porte un nom : la création artistique. La suisse le sait bien : au sud de sa frontière, la pompe italienne et l’industrie de la mode milanaise, de l’autre, l’austérité bernoise et ses écoles d’ingénieurs. À l’ouest, versailles et la fashion week parisienne, et ici, le secret bancaire en cure de fin de vie, mais tout de même l’ingénieuse horlogerie. La question qui se pose alors est économique : quel risque encourt, de ce point de vue, une société sans luxe ?
La fable des abeilles
C’est à Londres, en 1714, que Bernard Mandeville publiait la version accomplie de sa célèbre Fable des abeilles, ou les vices privés font le bien public. Il y dénonçait les vertus inefficientes de la modestie, de la décence et de l’honnêteté. Pour lui, la convoitise, l’orgueil et la vanité étaient au contraire les vrais ressorts de la richesse et de l’ardeur au travail, car ils concordaient avec les penchants naturels (et donc plus efficaces) de l’humanité, ce qui ne manqua pas de faire scandale. Il inspira néanmoins de grands penseurs, au premier rang desquels Adam Smith et sa théorie de la main invisible, selon laquelle l’action guidée par l’intérêt personnel est meilleure contributrice de richesse que la norme imposée. Chose amusante, Adam Smith reliait ainsi son efficience au luxe de Mandeville, via l’invisible.

Mandeville postulait en outre que satisfaire l’extravagance du riche donnait du travail aux pauvres et faisait tourner l’économie. Pour lui, le libertin agissait de tous temps certes par vice, mais sa prodigalité donnait du travail à de nombreuses corporations (tailleurs, parfumeurs, cuisiniers, femmes de mauvaise vie), qui à leur tour employaient des boulangers, des charpentiers, etc. Malheur à celui qui ferait fuir les riches : car ce n’est pas seulement qu’ils sont partis, ceux qui chaque année dépensaient de vastes sommes, mais les multitudes qui vivaient d’eux, prévenait-il. Son apologie du luxe au profit d’une élite motrice de l’économie n’est pas sans nous rappeler les débats sur les forfaits fiscaux, il n’y a pas si longtemps, en Suisse romande, lesquels, pour les mêmes raisons, furent conservés. Rappelons-nous également que le chiffre d’affaires global du luxe dans le monde pourrait atteindre 2 500 milliards d’euros en 2030… Voilà de quoi nourrir pas mal de monde. Le luxe et son ostentation se sont-ils affranchis des interdits moraux luthériens ? Pas sûr. On peut d’ailleurs s’étonner que l’industrie du luxe s’en préoccupe si peu, du moins ostensiblement. Avec un peu d’expérience sur ce terrain philosophique, l’horlogerie suisse aurait peut-être mieux anticipé d’autres interdits moraux plus récents, confucéens ceux-là, tout juste revisités par le dogme communiste chinois du Président Xi Jinping.
Luxe et innovation
Au final, la part d’invisible du luxe demeure la plus grande alliée de ce secteur hyper-créatif et fortement identitaire à la fois. D’ailleurs, s’il conserve une telle place dans l’économie mondiale, c’est que son modèle inégalitaire plaît toujours. Quoi qu’en disent les tenants des discours sociaux, ils ne se privent eux-mêmes jamais d’y goûter, lorsque l’occasion l’exige et que les budgets le permettent.
dès lors qu’il est rattrapé par la masse, le fournisseur de luxe doit impérativement remplacer son objet déchu.
La raison en est simple : le luxe est lui-même l’ordonnateur de l’ascenseur social, le metteur en scène de la réussite, le régisseur du bon karma, diraient les Indiens. Mais cette fonction, encore mal étudiée dans la littérature du luxe, ne peut être conservée que si le luxe préserve continuellement son avance altière. Aussitôt qu’il est rattrapé par la grande consommation et risque d’être pétri par son nombre gravitationnel, il doit monter d’un cran.
Dans le luxe, l’ennemi du bien n’est jamais le mieux, mais la masse. Ce jeu d’ascenseur de strates en strates révèle une dynamique très spécifique au marché du luxe. Dès lors qu’il est rattrapé par la masse, le fournisseur de luxe doit impérativement remplacer son objet déchu. Il fut un temps où la consommation d’épices, que l’on trouve aujourd’hui dans tous les supermarchés, constituait un luxe. Que lui substituer ? D’autres épices ? D’autres saveurs ? D’autres usages ? La grande réponse fut la marque-icône (grec ancien εἰκών, eikôn, « image ») que l’on rend intouchable, sacrée, grâce à la puissance de sa charge symbolique (Chanel N°5, sac Kelly, etc.).

à son bras, un incontournable du style de l’icône.
Sinon, le luxe n’a pas d’autre issue, pour maintenir la distance ascendante, que de créer sans cesse et d’innover au plus haut. Luxe et innovation ont d’ailleurs toujours fait bon ménage. Prouesses technologiques en architecture de luxe depuis l’Antiquité, performances d’orfèvres ou d’ébénistes, technologies d’horlogers ou de constructeurs automobiles, améliorations éthiques des textiles ou des cosmétiques, les producteurs de luxe ont toujours su tirer un immense parti des progrès de la science, quand ils ne les ont pas suscités eux-mêmes.
le luxe n’a pas d’autre issue, pour maintenir la distance ascendante, que de créer sans cesse et d’innover au plus haut.
Ce qui compte, c’est que les résultats affichés par l’inventivité aillent toujours vers plus de finesse, de légèreté, de pureté, de miniaturisation, de transparence, d’élégance et bien sûr de confort, tous critères conformes au dégagement des pesanteurs et marquant l’altitude. Imaginer que, par respect des traditions, le luxe serait réfractaire à l’innovation, serait commettre un contresens.

La tradition ne se résume pas à la conservation de techniques artisanales : c’est aussi et surtout un discours qui permet notamment au client du luxe de s’offrir le futur dont il rêve ou le passé qu’il n’a jamais eu (certains disent de s’auto-ancestraliser), par exemple en acquérant des châteaux, des meubles ou des voitures vintage. L’explosion du vintage réactualisé, devenu un véritable langage culturel, en est la preuve manifeste. Qu’il s’agisse des nouvelles Mini, des Panerai Due, des collections Zenith Heritage, des rééditions de la Porsche 911, des Rolex Submariner intemporelles, des sacs iconiques d’Hermès ou encore des boîtiers Leica ou Rolleiflex revisités, ces icônes réinterprétées montrent que l’innovation ne naît pas toujours de la rupture, mais bien souvent de la relecture intelligente des formes, des usages et des savoir-faire historiques.

Mais, autre particularité, le discours du luxe incombe aussi au client. en effet, ce que le luxe donne à voir relève certes de l’ingénierie de perfection pour le produire, mais avant tout, comme nous l’avons indiqué, de la culture pour en reconnaître les saveurs et les vibrations, et pour attester de la pérennité de son exclusivisme. Car seule la culture peut conférer les mots justes permettant de désigner la nature de l’expérience vécue et d’en jouir. Un grand vin peut recéler plus de 1 000 molécules olfactives. quand le meilleur œnologue en distingue parfois dix, le profane ne boit que du vin. que savourer de lui si l’on ne sait dire le gras de sa robe, son tuilé, ses arômes miel de châtaigne ou poivre noir, sa note boisée, fumée ou de fleurs blanches, sa complexité ou encore sa persistance en bouche et ses tanins ? Que comprendre d’un opéra si l’on ne sait discerner la tessiture d’une voix, la profondeur d’un violon ou les registres de couleurs d’un piano, sa touche, sa stabilité ou sa puissance ? Que dire d’un palais si l’on méconnaît son histoire ?
imaginer que, par respect des traditions, le luxe serait réfractaire à l’innovation, ce serait commettre un grave contresens.
Le luxe ne se résume donc pas aux sentiments de jouissance, même rares et chers, qu’il provoque. un tour en montagnes russes en foire y pourvoirait très bien. Il ne se condense pas davantage dans le mystère, qui finalement ne vaut que parce qu’il est tu. Pour que le luxe demeure visible dans nos sociétés, il doit continuer de maîtriser ses ressources invisibles, admirablement puisées dans le mythe et l’inconscient du sacré.
Pour paraphraser Mircea Eliade, le luxe comble les mythes oubliés, les symboles déchus, les hiérophanies abdiquées. il resacralise.



