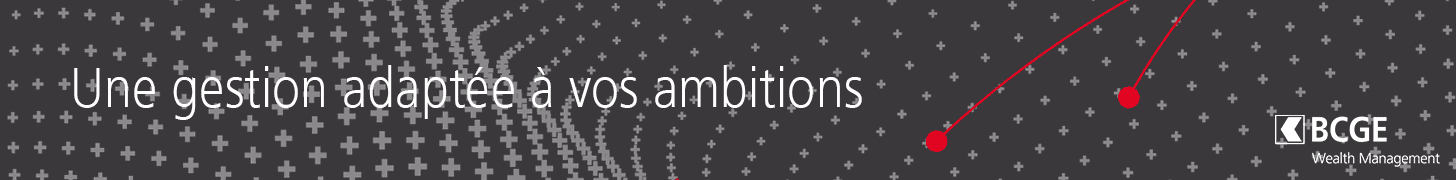Que les influenceurs occupent aujourd’hui une place centrale dans les stratégies de communication sur les réseaux sociaux relève de l’évidence.
Que ces influenceurs, qui valident chaque jour un peu plus l’importance de la digitalisation des marques de luxe, en fassent leur terrain de jeu, narcissiquement gratifiant, en est une autre, plus inquiétante et plus sérieuse.
Dans l’appel d’air de la mode, le poids des influenceurs ne cesse de croître dans la performance médiatique des marques de beauté de luxe et de prestige. Selon un récent rapport de Launchmetrics, « ils s’imposent comme le levier le plus dynamique d’un secteur en pleine mutation ».
Ce n’est pas le luxe qui lasse : c’est le discours sur le luxe.
Autour de ces figures d’un genre nouveau s’est installée une fascination étrange, presque malsaine. Leur jugement, souvent opportuniste, repose sur un système binaire de « j’aime / je n’aime pas », de likes et de vues.
C’est une incise dans le réel, une gifle à la distinction qui nous prend par surprise et secoue, chahute, fait bouger les lignes et les échelles de valeurs d’un monde de l’image et du corps désabusé, qui s’ennuie de ses propres conventions.
Par un jeu de connivences lourdes et d’identifications légères, un même fantasme tenace irrigue de plus en plus les stratégies des marques de luxe ouvertes aux quatre vents : tenter encore et encore le coup d’un luxe accessible.
En période de crise et de doute, tout est bon à tenter, quelles qu’en soient les conséquences prochaines.
Comment expliquer l’aura que nous leur prêtons ? De quel savoir-faire, de quelle expérience, de quelle légitimité tirent-ils ce pouvoir supposé d’influence ? Peut-être de notre seul désir — insensé — de croire qu’ils en ont un. Intrigués par leurs cohortes de followers, hypnotisés par une visibilité amplifiée par les algorithmes, nous finissons par ériger cette exposition en vertu.
Car leur seule légitimité, en réalité, est numérique.
Elle naît de la mécanique de nos pulsions : fabriquer des petits mythes, des légendes contemporaines, inventer des héros, projeter sur des silhouettes anonymes une puissance que nous leur offrons nous-mêmes. Si nous détournions les yeux, leur éclat s’évanouirait aussitôt. Leur pouvoir d’influence naît de notre regard, et disparaît avec lui.
Le luxe n’a jamais été inventé pour être « influencé ».
Chaque influenceur improvise son analyse comme on pousse la chansonnette : interjections, punchlines, certitudes instantanées. Ce discours creux trouve pourtant écho dans des observatoires de tendances ou des journaux du luxe qui craignent de rater la « dernière disruption » ou la prochaine égérie. On commente, on surinterprète, on donne du sens à des pensées d’un jour. Tout tourne en rond, dans un petit théâtre qui ne tourne plus très rond.
Dans cette valse un peu folle, ce n’est pas le luxe qui lasse : c’est le discours sur le luxe.
Un discours devenu bruyant, insistant, trivial parfois — et c’est peut-être cette insolence, cette brutalité assumée qui séduit une époque en quête de secousses, « d’effets waouh » plus que de nuances. Le choc plaît plus que la compréhension.
Mais n’oublions jamais que ce système, c’est nous qui l’avons bâti. Nous en sommes les artisans et les savants fous, fascinés par des individus qui, souvent, n’accomplissent presque rien ou pas grand-chose — si ce n’est exister sous notre œil.
Nous portons donc une responsabilité collective :
– Qui érigeons-nous aujourd’hui en star ?
– Sur quoi repose notre fascination ?
Sur une forme de vacuité assumée, sur un voyeurisme tranquille, sur une oisiveté cool presque revendiquée.
Il y a encore peu, le luxe se tenait loin du vacarme numérique. Il protégeait sa rareté, cultivait son mystère et sa sophistication, sculptait son récit. Il avait encore conscience du danger de sa dilution et bientôt de sa disparition.
Aujourd’hui, il se livre à une armée d’influenceurs dont la mission — faire du bruit — contredit frontalement les fondations mêmes du prestige.
Que reste-t-il du sac iconique quand il apparaît dix fois par heure dans des stories, posé entre un matcha latte et un code promo ? Que reste-t-il du sac iconique lorsqu’on le traîne comme un doudou dans tout l’appartement ? (sac Valérie de Jacquemus par Charlotte Le Bon)
Que devient la magie d’une maison quand elle se dissout dans un flux où tout se ressemble, tout s’achète et tout s’use ?
Le tempo des influenceurs est incompatible avec celui du luxe.
Ils doivent produire sans cesse pour continuer d’exister ; rester visibles plutôt que signifiants. Leurs mots réduisent l’esthétique à des slogans : «must-have», «coup de cœur», «tendance du moment». Rien sur l’histoire, sur le geste technique, sur la culture, sur la vision artistique. Rien sur la substance.
Le luxe devient alors décor, accessoire, hashtag.
Les marques, hypnotisées par des chiffres souvent artificiels — audiences gonflées, likes achetés — se laissent entraîner dans des collaborations qui n’apportent ni désir, ni crédibilité, ni profondeur. Car ce que les influenceurs offrent n’est pas une communauté : c’est une accélération. Une uniformisation des codes. Une vacuité visuelle où les mêmes poses, les mêmes filtres, les mêmes scénarios se répètent interminablement.
Comme si l’exposition permanente n’était pas déjà une forme de destruction.
Le luxe mérite plus qu’un alignement de contenus sponsorisés.
Il mérite la lenteur. La singularité. Les pleins et déliés, les nuances. Le regard cultivé de véritables passeurs — car des influenceurs, il y en a toujours eu, et de magnifiques.
Ce que les influenceurs offrent n’est pas une communauté : c’est une accélération.
Mais parce qu’il croit devoir suivre les caprices d’une génération Z boudeuse, le luxe court après un train qui n’est pas le sien, s’épuise à vouloir rattraper une temporalité qui lui est étrangère.
Ce dont il a réellement besoin, c’est qu’on lui rende ce qui le fonde : du sens, de la cohérence, de la densité, de la tenue, une légère élévation pour transcender la crudité de l’époque, une manière d’habiter le monde et d’érotiser le réel — autrement dit la condition première au désir.
Le luxe n’a jamais été inventé pour être « influencé ».
Il a été inventé pour être désiré.
Et le désir, lui, ne naît jamais du bruit.